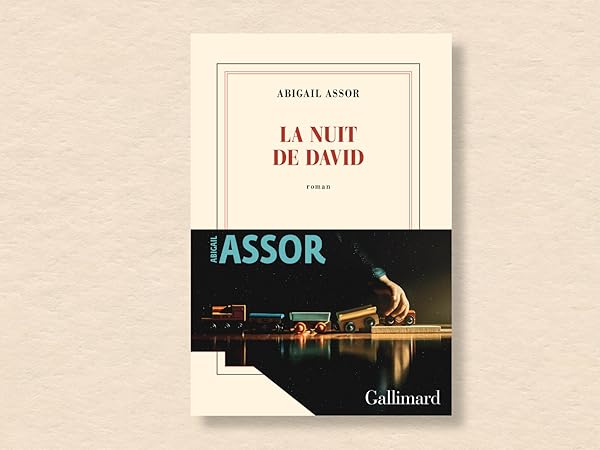Après « Aussi riche que le roi », vous vous aventurez dans un registre très différent avec « La nuit de David ». Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous a poussé à aborder des thèmes aussi lourds que personnels à savoir la maladie psychique, la gémellité ou le rejet de la famille ?
Après un premier roman avec un ancrage territorial fort, j’avais à cœur d’explorer d’autres facettes de mon écriture. Je crois que le talent d’un auteur, c’est aussi d’avoir une palette variée et je me méfie toujours de la tendance à écrire des livres qui se ressemblent. J’aime l’idée d’être capable de produire des textes éloignés les uns des autres. J’ai voulu aborder dans ce roman non pas la maladie psychique – rien n’indique que David souffre de quoi que ce soit, c’est justement la question centrale du livre – mais le système familial, comment celui-ci peut être écrasant et comment certaines questions non réglées au niveau des parents peuvent éclore à la génération suivante, souvent à travers la souffrance. Et il est facile de confondre la souffrance d’un enfant avec une maladie. Pourtant, la souffrance chez l’enfant indique plutôt que quelque chose ne va pas, non pas chez lui, pas dans l’environnement familial. Pour moi, ce ne sont pas des thèmes lourds, au contraire : il s’agit de quelque chose de particulièrement ordinaire, toutes les familles sont concernées. Le livre demande : comment accueillir un enfant dans le registre qui est le sien ? Nos attentes envers les enfants sont-elles raisonnables ? S’il y a un fou dans cette histoire, est-ce vraiment celui qu’on croit ?
Le roman est narré par Olive, la sœur jumelle de David. Pourquoi avoir choisi ce point de vue si particulier pour raconter cette histoire ? En quoi sa perspective enrichit-elle le récit de la maladie psychique de son frère ?
A nouveau, rien n’indique que David ait une maladie psychique. C’est un enfant difficile, certes. Mais quand un enfant crie, ne vaut-il pas mieux se demander ce qu’il cherche à dire ? Quand un enfant s’enfuit, ne vaut-il pas mieux se demander pourquoi il veut partir ? Olive est une sorte de miroir inversé de David. Contrairement à son frère, elle a très vite intégré ce qui était attendu d’elle. Elle connaît les codes pour se faire aimer, dans une famille où, comme dans tant d’autres, l’amour est conditionnel : elle est excellente à l’école, ravissante, sage, quand son frère hurle, casse, cherche à s’enfuir. Elle semble plus aimée que son frère, quand en réalité, l’amour ne circule pas dans ce foyer : David est diabolisé, Olive est idéalisée, et la diabolisation comme l’idéalisation sont les contraires de l’amour. Cette perspective d’enfant idéal, et pourtant malgré tout dans une souffrance sourde, me paraissait intéressante pour explorer comment ce qui cloche ne se situe pas toujours chez les enfants, mais bien souvent chez les parents.
Vous parlez dans le livre de la nuit où tout a basculé, celle où Olive « perd » son frère. Quelle est l’importance de ce moment dans la construction de l’histoire, et comment symbolise-t-il la rupture entre l’avant et l’après dans la vie des personnages ?
Cette nuit est certes celle de la séparation, mais surtout elle est celle de la fin de l’enfance. David et Olive, les jumeaux fusionnels, prennent des chemins séparés, notamment parce qu’Olive choisit d’une certaine manière le camp des adultes au camp de l’enfance. Elle n’avait peut-être pas d’autres choix, c’était sans doute une nécessité pour grandir, mais à hauteur d’enfant, c’est quand même une trahison.
Le rejet de la famille est l’un des autres thèmes centraux de votre roman. Ce rejet est-il lié à l’incompréhension de la maladie, à la culpabilité ou à un autre facteur ?
Le roman donne des indices sur ce qui conduit la mère à refuser de comprendre son fils. Sa propre mère, le personnage de la grand-mère, est envahissante, intrusive, contrôlante. On peut imaginer que cette infantilisation garde la mère des jumeaux dans une sorte de tension, et qu’elle reproduit ce contrôle sur ses enfants, attendant d’eux d’être irréprochables, ce que David ne parvient pas à faire. On sent aussi la pression qu’elle ressent à être une mère parfaite, et la volonté inconsciente de tout quitter, notamment lorsqu’elle rêve, avec Olive, de s’enfuir pour Paris et de retrouver sa jeunesse. Les enfants agissant beaucoup par symbolisme, on peut imaginer que les tentatives de fuite de David sont des façons de montrer le chemin à sa mère. Il réagit à la souffrance qu’il ressent chez sa mère et qu’elle refoule. Malheureusement, celle-ci ne le voit pas ainsi, elle préfère imaginer que le problème vient de lui et qu’il a une maladie psychique. Pourtant, le seul médecin qui parle dans le livre, la psychiatre, précise bien que David n’a rien d’alarmant. Mais la mère refuse de l’entendre.
Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans l’écriture de cet ouvrage ?
C’est un ouvrage qui pose les questions plutôt que de donner les réponses. Je ne voulais pas d’un livre pédagogique, mais d’un livre ambigu, ambivalent, qui propose plusieurs lectures et où chaque personnage peut être à la fois incriminé ou innocenté selon le regard que l’on pose sur lui. Trouver cet équilibre était le plus grand défi de l’écriture.
Que vous a apporté « La nuit de David » ? Qu’a-t-il changé en vous ?
Je me suis attachée aux personnages, c’est comme si je les avais toujours connus. La fin de l’écriture a été douloureuse, ils m’ont énormément manqué. Mais aujourd’hui, c’est une joie de pouvoir échanger autour de ce livre avec les lecteurs, qui partagent souvent des souvenirs d’enfance, ouvrent le débat, se questionnent avec moi. Ce sont des conversations qui m’enrichissent énormément.